Dans son documentaire Cameraperson, la cheffe opératrice Kirsten Johnson passe à la réalisation. Avec ce film, elle met en scène un collage fascinant d’images inédites qu’elle a capturées durant vingt-cinq années en travaillant sur d’autres projets. Un long-métrage comme un testament historique. Mais aussi, et plus que tout, les mémoires intimes d’une magicienne de la figuration hantée par sa responsabilité de documentariste.
Nous aimons penser que notre existence se construit telle une histoire chronologique, avec du sens, une structure. Notre cerveau nous pousse dans cette direction, au point de déformer et réadapter les souvenirs à l’envi. Nous expérimentons notre vie comme l’on expérimente un roman ou un film. Pourtant, hors des ambitions d’auteur de notre encéphale, nous savons que cela est faux. Comme nous savons que ce que nous voyons dans les salles obscures est un mensonge élaboré et accepté de tou-te-s, une fuite commune vers l’altérité. Nous sommes des équilibristes existentiels.
Tout ici-bas est chaotique, insensé. Et Cameraperson ressemble à la vie. La cheffe opératrice Kirsten Johnson y utilise des images tournées pour ses précédents films, tels que Derrida (2002), Fahrenheit 9/11 (2004), The Invisible War (2012) ou encore Citizenfour (2014). Pourtant, ces productions n’ont aucune importance pour le documentaire qu’elle nous propose ici. Dans sa note d’intention en ouverture, la cinéaste demande à ce que nous, les spectatrices et spectateurs, considérions ce long-métrage comme un « memoir », un récit de souvenirs. Mais Kirsten Johnson, par son talent, a tout simplement créé un documentaire sur ce qu’exister et être au monde implique.

Cameraperson, réalisé par Kirsten Johnson, 2016. © Janus Films
Ce sentiment de voyager au cœur de sa psyché nous prend dès les premières minutes du film. Nous sommes dans l’œil de la réalisatrice, nous entendons ses commentaires, nous observons sa mise en scène, ses choix de plan, sa façon d’aborder interlocutrices et interlocuteurs. Car tout le paradoxe de Cameraperson se trouve là : sous ses airs de patchwork décousu, il s’agit en fait d’une tapisserie médiévale brodée avec le plus grand soin, traversée d’émotions et de subjectivité. Kirsten Johnson nous partage un peu d’elle-même, de ses larmes lorsqu’un garçon lui raconte comment il a retrouvé son frère mort à cause d’une bombe, de ses opinions quand elle dit à une jeune femme témoignant avec courage de son avortement qu’elle n’est pas « une mauvaise personne ». Les indications de lieux ne nous sont fournies qu’à dessein, et ponctuellement. Parfois, elles disparaissent, pour laisser les images se mêler à travers l’espace et le temps − lequel n’est jamais signifié explicitement. Par moments, les transitions sont rudes, on passe de l’Afghanistan au Yémen, puis à la Bosnie ou au Rwanda. Néanmoins, le tout est imprégné d’une certaine continuité, d’une aura familière.
Kirsten Johnson élimine tout didactisme de sa démarche. L’intelligence incroyable du montage ne cesse de nous bouleverser, nous faisant totalement accepter son univers, sa vision. Les formats des images et leur qualité variable viennent trahir la non-indication des dates, et notre mémoire collective s’active immédiatement face à des événements qui ont marqué notre passé, comme le 11 septembre. Mais au fond, qu’importent les dates. L’ensemble est lié par les gens, ces personnages presque irréels et pourtant si authentiques, dont Johnson saisit toute la complexité, voire l’essence. Elle réalise un film profondément humaniste, nous faisant dépasser la notion de frontière et les préjugés. En choisissant d’utiliser ainsi des images d’archives inédites, la cinéaste offre sa propre dissertation filmique sur ce qu’être documentariste signifie.
Cameraperson est une réflexion sur le témoignage et la valeur des images elles-mêmes d’un point de vue historique, ainsi que sur leur authenticité et la liberté d’interprétation qu’on leur appose. Johnson insère des moments partagés avec ses enfants, sa mère, telles des respirations. Cependant, on ne peut s’empêcher de retrouver dans sa façon de filmer obsessivement les mains et les gestes de ses proches, le même attachement et la même attention qu’envers ces inconnu-e-s qu’elle immortalise dans l’œil de sa caméra. Que ces gens soient de sa famille ou un soldat revenu d’Irak − expliquant qu’il préfèrerait aller en prison que retourner faire la guerre pour « tuer d’autres personnes pauvres ». La réalisatrice dévoile aussi des moments habituellement coupés au montage : des mouvements brusques de caméra, des regards directs, des commentaires de mise en place et d’éclairage… Elle montre ce qui n’est jamais montré, révèle la supercherie de la sacro-sainte objectivité journalistique. Kirsten Johnson met absolument tout ce qu’elle est dans son œuvre et efface toutes nos préconceptions. Elle maîtrise sa composition d’une manière virtuose, utilisant parfois des sons d’autres prises de vues sur celles qui apparaissent à l’écran. Mais surtout, la documentariste interroge son propre rôle avec l’intervention d’autres personnes, comme cette interprète qui lui explique être hantée par les témoignages de femmes victimes de viol, qu’elle doit écouter encore et encore en Bosnie. Johnson illustre le décalage entre des événements terribles et la fuite du temps, choisissant des plans fixes de lieux déserts où se sont déroulées ces atrocités. Elle se fait un devoir d’être celle qui témoigne tant du maintenant que de l’après.
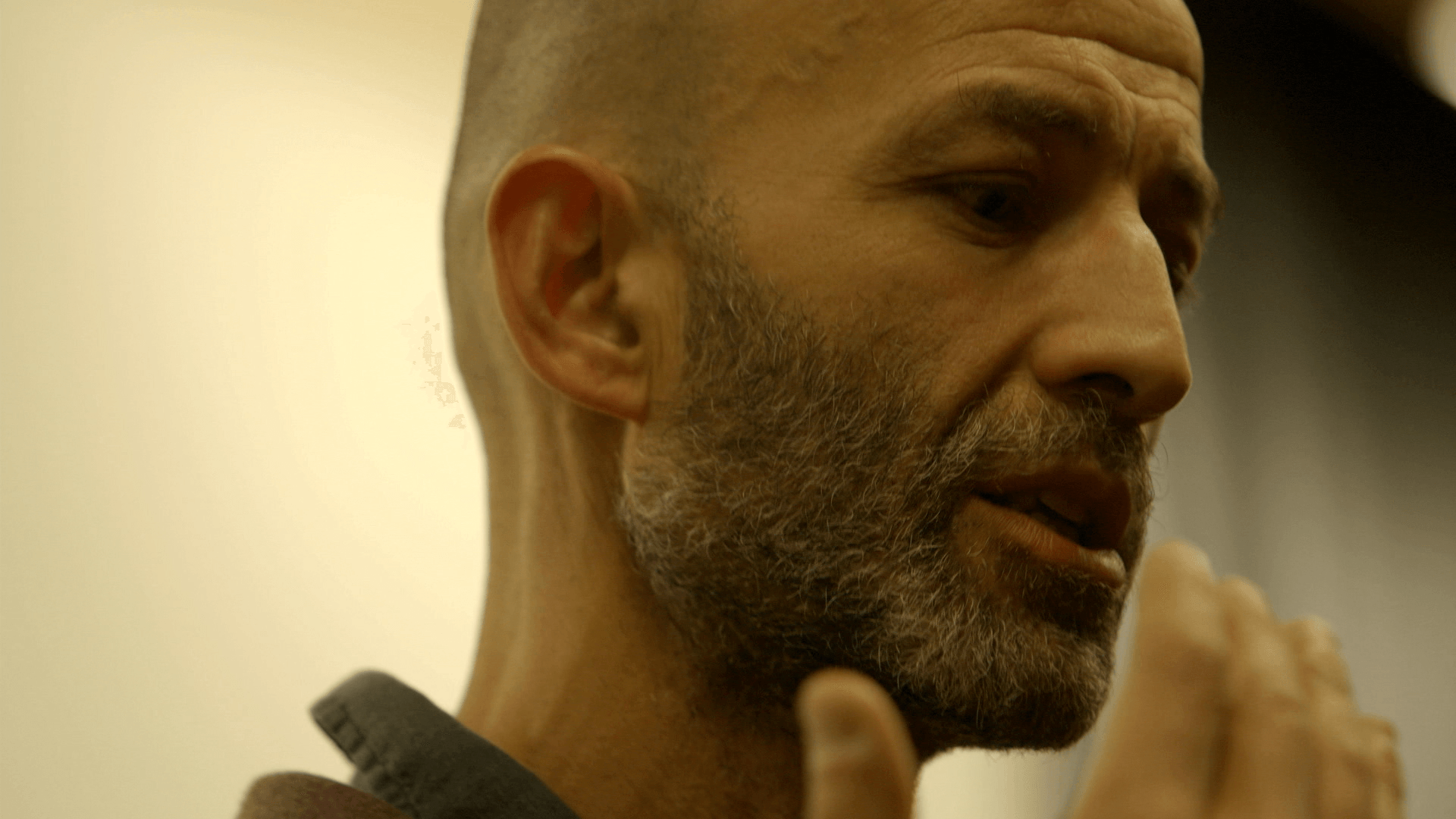
Cameraperson, réalisé par Kirsten Johnson, 2016. © Janus Films
La voix de Charif Kiwan, porte-parole du collectif de cinéastes syriens Abounaddara, hante notre inconscient : « Nous devons trouver des moyens de montrer l’horreur et la mort, en respectant une règle d’or : la dignité. » Cette phrase anime pour ainsi dire le long-métrage de Johnson, laquelle a filmé, en plus de vingt-cinq ans, le pire de l’humanité et les retombées de nos actes les plus abjects, mais aussi, quelquefois, les plus beaux. Chaque protagoniste présenté-e est entouré-e par la bienveillance de la documentariste. Là encore, c’est une prise de position. Quand Johnson filme sa mère, atteinte de la maladie d’Alzheimer, on l’imagine évoluant sur un fil, incertaine de ce qui doit rester en hors champ ou non. Mais c’est cet attachement à l’autre, étroitement lié au rôle de la réalisatrice, qui fait de Cameraperson une œuvre si brillante et singulière.
Kirsten Johnson fait d’un objet filmique celui de la passation de savoir, d’un héritage. Un testament sur la responsabilité des documentaristes, et des médias plus largement. Le paradoxe de Cameraperson est de ceux qui nous laissent bouche bée pendant plusieurs heures. Considérer qu’un documentaire est un travail subjectif, un récit, sous-entend que celui-ci est scripté. Et en dépit des apparences, ce film n’est pas le résultat d’un composition hasardeuse. Il raconte, développe. Il est parcouru de thématiques − le racisme, la guerre, les violences faites aux femmes, les maladies mentales. Cameraperson comporte une évolution narrative. Et c’est le choix conscient de cet assemblage spécifique qui est la réponse à la question centrale : que dois-je montrer, et que dois-je cacher ? À cela, Johnson nous suggère qu’un regard en dit plus que 1 000 images voyeuristes.


