Audre Lorde, figure cruciale du mouvement féministe de la deuxième vague1, s’est battue toute sa vie contre l’homophobie et le racisme. Autrice d’une dizaine de recueils de poésie et presque autant d’ouvrages de prose, elle publie en 1980 Journal du cancer. Elle y raconte le douloureux parcours de la maladie, depuis la découverte de son cancer à sa mastectomie. Intense, cru, sensible, le récit nous embarque à ses côtés dans son combat, mêlant création poétique et questionnement politique. Une version française, sortie en 1998, nous permet de plonger au cœur d’un témoignage puissant, qui interroge le rapport entre la maladie et le statut des femmes.
La nouvelle tombe comme un couperet : Audre Lorde apprend à 44 ans qu’elle est atteinte d’un cancer du sein et qu’elle doit subir une ablation. Il lui faut, dans un premier temps, réaliser l’impact de la maladie, son sens et ses conséquences. Elle tente d’absorber le choc et de faire face, mais surtout, de ne pas se laisser aller à l’absurdité de cette annonce.
En parallèle de l’incompréhension, elle entreprend des recherches fouillées, où elle étudie tout, des conséquences de l’ablation aux traitements alternatifs. Elle choisit finalement la mastectomie. Ce temps de réflexion lui permet de rester au cœur de la décision et de conserver sa capacité d’autodétermination.
Puis elle raconte la peur de l’anesthésie, un trou noir où l’esprit se perd, et le réveil, pénible et embué. Elle décrit la douleur, rappel lancinant du manque, physique et psychologique, d’une partie d’elle. Audre Lorde couche sur le papier sa vie postopératoire, la temporalité étrange de l’hôpital, la semi-conscience, la peine physique, la mort, proche, mais surtout la vie :
25 septembre, quatrième jour. Les choses apparaissent et disparaissent tellement vite qu’on dirait des éclairs ; les journées sont magnifiques, mordorées et bleues ; je voudrais être dehors pour en profiter, je voudrais être heureuse d’être en vie, je voudrais être heureuse de toutes ces choses dont je devrais être heureuse. Mais maintenant, j’ai mal. Maintenant, j’ai mal. Les choses se courent après à l’intérieur de mon crâne, il y a des larmes que je n’arrive pas à verser et des mots comme cancer, douleur et mort. (p. 60)
Habiter les silences
Son diagnostic a représenté un basculement total, qui projette une lumière nouvelle sur son existence et renforce ses convictions militantes. Dans une optique résolument politique, l’autrice, qui se définissait elle-même comme « lesbienne-noire-féministe-mère-amante-poétesse », décide de faire le récit de son cancer afin d’enrichir le paysage littéraire de son expérience singulière :
J’allais mourir. Pas tout de suite mais tôt ou tard, et cela, que j’aie pris la parole ou non. Mes silences ne m’avaient pas protégée. Vos silences ne vous protégeront pas non plus. Mais le fait est : à chaque mot vrai, exprimé, à chaque vérité dite – ces vérités que je n’ai de cesse de poursuivre –, je suis entrée en contact avec d’autres femmes et, ensemble, nous avons élaboré une parole adaptée au monde auquel nous croyons toutes, un monde qui intègre nos différences. (p. 31)
À travers son vécu, elle espère ouvrir la voie aux femmes et participer au développement de la capacité de se penser et d’agir des minorités. Dans cette optique, elle décortique chaque émotion ressentie et ne fait l’impasse sur aucun sentiment (l’érotisme, la joie, la peur, la fatigue, la puissance) :
Plus tard, je ne veux pas que tout ça ne soit qu’un registre de souffrances. Qu’un registre de larmes. Je veux que ça puisse me servir, tôt ou tard, je veux pouvoir le transmettre et je veux prouver, me prouver que tout ça fait ma force, et que rien d’autre, rien d’autre ne pourra l’ébranler ni l’égaler pendant longtemps. Mon travail consiste à habiter les silences dans lesquels j’ai vécu et à les peupler jusqu’à ce qu’ils résonnent de la musique des beaux jours et du fracas de la foudre. (p. 60)
La sororité, ce mot méconnu dans notre langage courant, désigne la solidarité entre femmes2. À chaque étape de cette épreuve, Audre Lorde rappelle son importance. Tout d’abord, l’amour de sa compagne, Frances Clayton, dont la présence et le rayonnement l’extirpent de la froideur de l’hôpital. Mais aussi le soutien de toutes les femmes de son entourage :
Je sais seulement qu’un incroyable flot d’amour et de soutien me traversait, venu de toutes les femmes qui m’entouraient, et que j’avais l’impression de baigner dans un bain permanent d’énergies positives. […] Le parfum sucré de leur souffle, leurs rires et leurs voix qui m’appellent par mon nom, tout cela me redonne du courage et me ramène à mon envie de regarder ailleurs que vers le fond. (p. 53)
Après son opération, Lorde ne veut pas faire comme si rien ne s’était passé. Elle refuse de cacher sa poitrine, car pour elle, c’est nier le vécu de cette perte et se priver du soutien de ses sœurs de combat. Pour survivre et avancer, il ne faut pas se murer dans le silence :
Nous nous privons les unes les autres de visibilité et de soutien mutuel, lesquels sont pourtant des alliés précieux pour prendre du recul et s’accepter pleinement. Moi-même, entourée, jour après jour, par des femmes qui ont toutes l’air d’avoir deux seins, j’ai parfois du mal à me rappeler que JE NE SUIS PAS SEULE. (p. 78)
L’isolement de ces femmes empêche également de se rassembler politiquement pour lutter contre les discriminations et les causes environnementales. En 1980, on parle peu de ces thématiques, et on écrit et publie encore moins sur le sujet. Le slogan « le privé est politique », utilisé par les mouvements de libération des femmes à partir des années 1960, expose que les problèmes individuels de ces dernières sont le résultat de leur statut politique d’opprimées. Il nous rappelle que l’on a souvent écarté les problématiques féminines des débats publics, considérées comme étant de l’ordre de l’intime. Audre Lorde prône la mise au jour du vécu des femmes et la reprise en main de leur droit à l’expression.
Dénoncer la prothèse imposée
Quelques jours après son opération, une femme vient à sa rencontre et lui propose des prothèses pour sa sortie d’hôpital. Séduite par son enthousiasme, Audre Lorde l’écoute d’abord, pour vite déchanter :
Son message était, en substance, vous êtes aussi bien qu’avant par ce que vous pouvez retrouver exactement la même apparence. […] De la laine pour l’instant, puis une prothèse aussi vite que possible, et personne ne se rendra jamais compte de rien. (p. 56)
Elle constate que la seule chose qui importe aux yeux de la société après une ablation d’un sein, c’est l’apparence. Les sensations et l’érotisme sont écartés pour ne se concentrer que sur l’une des attentes principales envers les femmes : être dans la norme. La poétesse se détourne de la prothèse, rejetant l’artifice :
J’avais un air bizarre, décalé, spécial, mais tellement plus fidèle à moi-même, en un sens, et donc tellement plus acceptable qu’avec un truc fourré sous mes habits. Car aucune prothèse au monde, pas même la plus perfectionnée, ne pourrait réparer la réalité ni m’apporter les sensations que m’apportait mon sein, et soit j’aimerai mon corps avec un sein en moins désormais, soit je resterai pour toujours étrangère à moi-même. (p. 59)
Mais ce qui la choque le plus est la désapprobation de l’infirmière de l’hôpital lorsqu’elle découvre qu’elle ne porte pas de prothèse : elle l’incite alors fortement à « mettre quelque chose », au moins pour sa venue à l’hôpital…
J’en croyais à peine mes oreilles ! J’étais trop outrée pour répondre, mais ce n’était que la première d’une série d’attaques contre le droit, qui est le mien, de définir et revendiquer mon propre corps. […] Une femme qui s’efforce d’apprivoiser son paysage corporel et la nouvelle temporalité de son existence, de se réapproprier son corps, sa souffrance, sa beauté et sa force, cette femme-là est perçue comme une menace pour le “moral” du service d’un spécialiste du cancer du sein ! (p. 75)
L’autrice pointe l’absurdité de la gêne provoquée par la vue de ce « sein en moins », et la questionne : pourquoi tant de malaise face à une amputation mammaire ? Est-ce que l’on demande à un homme, malade ou blessé de guerre, de camoufler avec autant d’énergie ses blessures ?
Critiquer l’esthétique de la normalité
Son objectif n’est pas de diaboliser la prothèse, mais de laisser le temps aux femmes de faire l’expérience de leur « nouveau » corps, de ses lignes et des émotions qu’il procure. Ce qu’elle fustige, c’est son systématisme. Elle refuse de se cacher et de porter le statut de victime silencieuse :
À mes yeux comme à ceux des autres, je refuse d’être rabaissée du rang de guerrière à celui de victime, sous prétexte de me rendre plus acceptable ou moins dangereuse pour les béni-oui-oui, ceux qui pensent qu’en recouvrant un problème, il cessera d’exister. Je refuse d’avoir à dissimuler mon corps pour mettre plus à l’aise un monde qui a la phobie des femmes. (p. 76)
Elle s’oppose à l’âgisme ambiant envers les femmes, qui, passées un certain cap, ne sont plus considérées comme des êtres désirants et désirables. Le cancer du sein impacte le plus souvent les personnes entre 40 et 55 ans, et « c’est précisément l’âge auquel les femmes, dans la description qu’en font les médias grand public, se flétrissent et voient décliner leur identité sexuelle » (p. 80), écrit-elle.
Les corps des femmes doivent correspondre à des injonctions fortes de la société : jeunesse, minceur, harmonie, beauté… Alors que les cicatrices pourraient − et devraient − être des marques de résilience, elles sont souvent vécues comme une honte. Celui d’un corps déformé, donc, par extension, moins féminin. Elle combat le validisme3 de la société et remet au centre de la discussion la fonctionnalité du corps, plutôt que son apparence :
Ceux qui insistent tant sur la nécessité de porter des prothèses après une opération du sein ne font que répercuter l’attitude commune de notre société qui considère les femmes en général comme des commodités sexuelles, réduites à des objets dépersonnalisés. Nous avons été programmées pour aborder notre corps non pas comme nous-mêmes nous le percevons, et souhaitons nous en servir, mais comme les autres le voient et le perçoivent. (p. 80)
La maladie dans un système inégal
C’est également tout le système de santé que l’autrice interroge : selon leur couleur de peau ou leur classe sociale, les femmes n’ont pas les mêmes chances de survie. Les personnes racisées ou ayant peu accès à l’instruction continuent de subir une mortalité plus élevée que les femmes privilégiées. Elles consultent plus tardivement et disposent de moins de choix thérapeutiques :
Ce n’est un secret pour personne que le cancer du sein est en augmentation chez les Américaines. Selon les taux de mortalité établis par l’American Cancer Society elle-même, seules 50 % des femmes touchées sont encore en vie trois ans plus tard. Ce chiffre tombe à 30 % si vous êtes pauvre ou noire, ou que vous faites partie d’une manière ou d’une autre des classes les plus défavorisées de cette société. (p. 78)
Elle questionne aussi l’omniprésence de certains types de traitements, ainsi que le manque de recherche et d’investissement dans les thérapies alternatives. Le cancer du sein est de plus en plus fréquent, et malgré la multiplication des contrôles de dépistage, la mortalité peine à baisser. Elle pointe du doigt des systèmes biaisés et influencés par les lobbies : les traitements occidentaux sont toujours privilégiés, écartant souvent les approches holistiques et alternatives.
Enfin, alors que son cancer prolifère, elle critique un monde absurde, dans lequel la nourriture que nous consommons est toxique, la terre est maltraitée et nos corps finissent par être impactés :
C’est à nous de nous protéger en allant chercher toutes les informations disponibles sur le traitement du cancer, sur ses causes, sur les découvertes récentes concernant l’immunologie, la nutrition, l’environnement et le stress. (p.90)
Journal du cancer est un concentré de beauté et de résilience : Audre Lorde nous attrape et nous oblige à faire face au monde dans lequel nous vivons. Terriblement actuels, ses questionnements sur les corps des femmes, la différence, la maladie et le patriarcat nous montrent le travail qu’il reste à accomplir. Avec amour et combativité, elle nous invite à nous exprimer et à nous réunir, ensemble, femmes de toutes couleurs, âges et orientations sexuelles. Elle nous pousse à nous battre pour le droit d’exister et de survivre dans un environnement souvent hostile. Sa sincérité et son courage en font une poétesse de référence, mais surtout, l’alliée de quiconque aspire à un monde plus censé et sensible.
1 La deuxième vague féministe émerge dans les années 1960-1970 aux États-Unis. Alors que la première vague se concentrait sur le droit de vote et les questions liées aux obstacles légaux de l’égalité des « sexes » (droit à la propriété, divorce…), la deuxième étend le débat à des problématiques plus larges, comme la sexualité, la famille, le travail ou les droits liés à la procréation. Ses militantes attirent l’attention sur la violence domestique, créent des refuges pour les femmes violées ou battues, et exigent des adaptations des lois sur le divorce et la garde des enfants.
2 Ce terme a d’abord été utilisé par les féministes dans les années 1970 afin de faire entrer dans le langage commun l’équivalent féminin de « fraternité ». Le terme anglais « sisterhood » avait également été fabriqué par les mouvements féministes américains en réaction à « brotherhood ». La sororité désigne les liens entre des femmes qui partagent des affinités et un vécu commun, dus à leur condition féminine. Les mouvements féministes ont également promu la diffusion de l’utilisation du mot « adelphité », qui désigne ce même sentiment de confiance, de complicité et de solidarité dans une relation entre hommes et femmes, dans le cas de frères et de sœurs ou d’ami-e-s par exemple.
3 Le capacitisme (ou validisme) est une forme de discrimination, de préjugé ou de traitement défavorable contre les personnes vivant un handicap (paraplégie, tétraplégie, amputation, malformation, mais aussi dyspraxie, schizophrénie, autisme, etc.).
Image de une : Portrait d’Audre Lorde pour Deuxième Page. © Camille Berberat
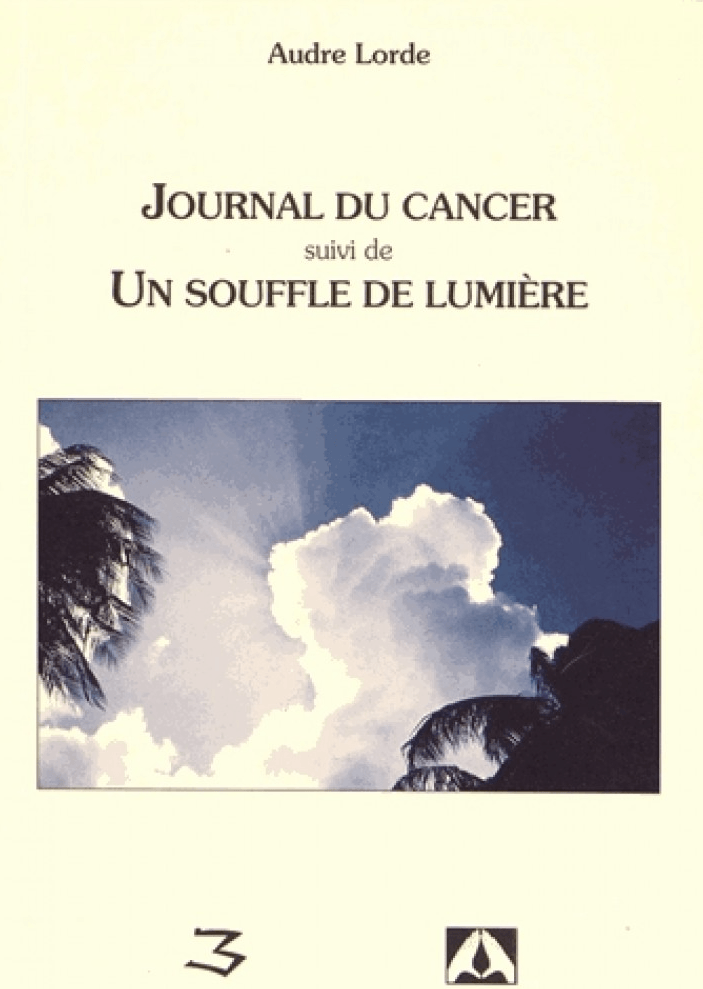 Journal du Cancer
Journal du Cancer Mamamélis
1re édition - printemps 1998
206
Audre Lorde, Frédérique Pressmann (traduction)
18 €
Une des écrivaines américaines les plus connues aux Etats-Unis, poète et essayiste est décédée en novembre 1992. Dans son journal, publié en langue originale en deux parties, elle raconte sa maladie, sa lutte et son recours aux médecines alternatives. Politiquement engagée dans la cause noire comme dans le mouvement des femmes, elle nous fait partager les engagements de la fin de sa vie, sa confrontation personnelle avec la peur, la force et la joie de vivre.


