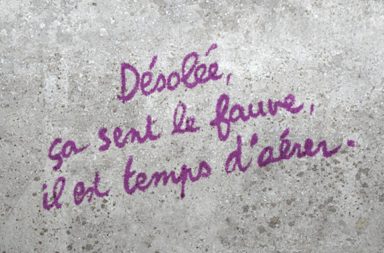La mémoire et les douleurs des femmes se transmettent de génération en génération. Leurs forces aussi. Les femmes d’aujourd’hui les portent en elles et les partagent ; elles les chantent. C’est ce que raconte ce texte avec pudeur. Trois femmes pour des milliers d’histoires, celles de leurs aïeules, celles de leurs sœurs dans le monde entier, celles de toutes les leurs, femmes du passé et du présent. Car la résilience passe évidemment par la sororité.
Elles sont trois sur le pas de la porte. Trois, comme dans les chansons et les vieilles histoires.
La porte est celle d’une vieille maison en Charente, et nous venons d’y terminer une résidence de travail.
Je suis l’une des trois. Nous sommes trois chanteuses.
L’une est serbe, l’autre d’origine arménienne, et moi, je viens d’ici.
La branche de ma famille que je connais le mieux a vécu dans cette maison en pierres, rénovée par mes parents. Elle a été transmise, la plupart du temps, par les femmes. Ma lignée l’occupe depuis plus de deux siècles, et le village où elle se trouve est bien plus vieux encore. Nous venons de passer trois jours à chanter des chansons traditionnelles de nos trois pays et de quelques autres.
À l’heure de partir, à la fin de notre résidence de travail, je me sens étrangement remuée…
Je suis seule sur le pas de la porte, j’attends mes amies.
Je contemple la rue qui prolonge l’entrée de la cour de cette maison, et j’ai cette sensation étrange que, à travers moi et le regard que je porte sur le paysage qui s’offre à moi, ce sont les femmes qui ont vécu dans cette maison avant moi qui le regardent. Marie, Célestine, Juliette, Anne… Toutes les autres. Toutes celles qui se sont un jour tenues sur son seuil, qui m’y ont précédée et qui, elles aussi, ont regardé.
J’ai depuis toujours, je crois, cette conscience aiguë d’être dépositaire de racines qui affleurent encore à la surface de ma mémoire, en plus d’être encore tangibles à la surface de la Terre – cette maison, elle est là, toujours debout.
En partageant ces émotions avec les deux autres qui me rejoignent, quelque chose se passe.
L’une d’elles regarde l’autre, et finalement dit ceci : nos lieux anciens à nous, ils n’existent plus.
C’est une simple constatation ; ce n’est pas triste. C’est exprimé sans ressentiment. C’est leur histoire. Celle de peuples qui se relèvent, avancent, reconstruisent, se retrouvent.
Nous sommes trois, immobiles, sur le seuil d’une maison en pierres.
Et à travers nous trois, c’est comme si nos aïeules se voyaient et se reconnaissaient : celle qui est restée toute sa vie dans un périmètre de vingt kilomètres autour de cette maison, à travailler, voyant partir à la guerre tous les hommes autour d’elle ; cette autre femme, épouse d’un rebelle arménien mort à l’âge de 35 ans, qui a traversé toute l’Europe avec son bébé dans les bras, échappant à des dangers que l’on préfère ne pas imaginer ; ces autres encore, serbes, macédoniennes, paysannes pleines de feu, avec dans le regard le désespoir de celles et ceux dont la terre est régulièrement annexée, brûlée, ou pillée.
Ces femmes, si différentes, à travers nous se rencontrent et se rassemblent. Elles fabriquent le pain avec les mêmes mains gercées, récoltent le contenu de leur soupe dans la même terre, allaitent leurs petits avec les mêmes seins et les pleurent avec les mêmes larmes lorsqu’ils partent à la guerre.
Et ce sont peut-être les mêmes rêves informulés qui les font se tenir debout sur le seuil de leurs maisons, et partir – même si partir ne consiste parfois qu’à parcourir sans relâche les replis de leur mémoire.
Nous sommes trois, aujourd’hui, sur le seuil d’une vieille maison en pierres…
Image de une : illustration spécialement réalisée pour Deuxième Page. © Camille Berberat